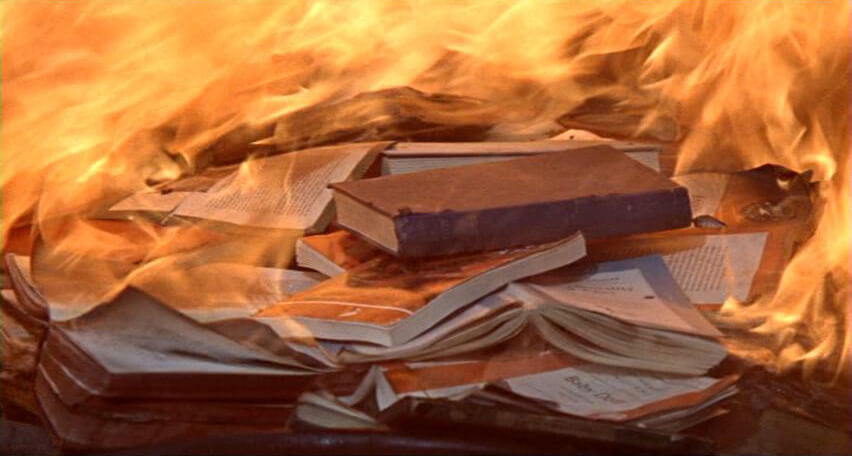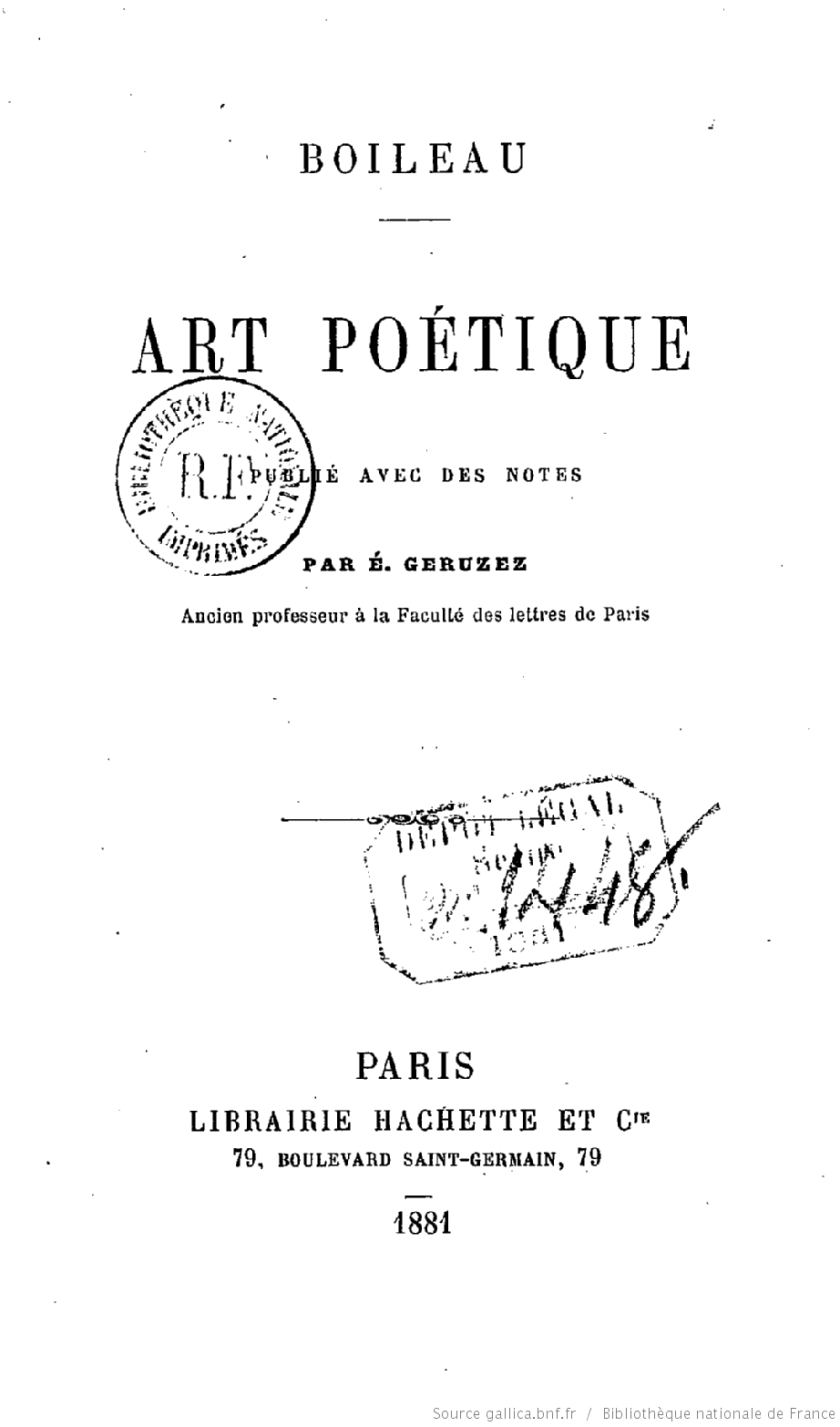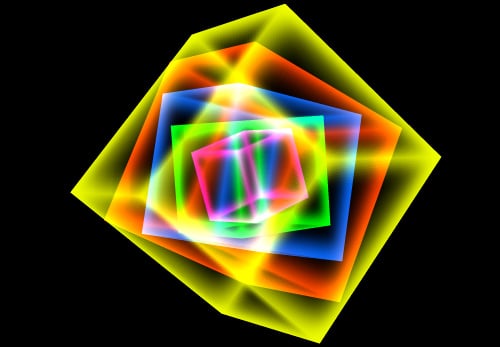Trop de baratin pour être Charlie. Pas assez de répartition pour avoir le luxe d’être esthète. Sombre et simpliste, le son doit l’être, en adéquation avec l’époque pour être percutant. Booba s’inscrit dans ce sillage, la mort du Hip-Hop, la domination du rap. Un monde où tout n’est qu’histoire de force. #Skywalker.
On a tout dit sur Booba, même des choses vraies. Jadis boycotté, il voit désormais ses propos relayés par les plus grands médias généralistes, ce qui n’est pas vraiment un hasard: aujourd’hui, il ne semble être qu’un millionnaire de plus persuadé que sa petite vie ennuyeuse est digne d’être diffusée chaque jour sur le Net. Pas de quoi affoler BFM ou Canal. Développé couché, voitures de luxe, baby shower. À la vue de tous ce peuple grappillant un peu du rêve américain.
La carrière de Booba, ça fait un bail qu’elle ne repose plus (que) sur sa musique – il est toutefois loin d’être le maître Yoda du marketing que ces tasspech’ de rédactrices fraîchement diplômées s’imaginent (même si sa petite personne est devenue un produit à elle seule, torse huilé compris). Puis il y a eu LVMH. Lui qui en était venu à s’afficher chez tous les collabos d’ici et d’ailleurs – ravis d’avoir trouvé le candidat idéal pour ridiculiser une fois de plus ces singes qui s’agitent – serait donc encore capable de quelques rares fulgurances.
LVMH. Une agréable surprise en quatre lettres, mais pas une révolution non plus garçon. Plutôt une sucette de plus aux champions du CAC 40. Les lyrics restent imagés. Pathétiques, aussi, comme l’époque. « Je prends des millions, tu prends des selfies » Booba n’a jamais été si loin de son auditeur, et si proche de la petitesse ordinaire de tout un chacun (l’humour en plus, peut-être). « Que dieu me pardonne d’être un homme comme les autres », glisse-t-il lui-même.
LVMH, c’est surtout une putain d’instru qui rappelle un temps pas si lointain où ça niquait des mères en jogging à bouton pression. Ultime contradiction entre la forme, sombre, et la vie de rêve dans une ville connue pour être une chatte bien poilue ne demandant qu’à se faire fourrer. Suffisant pour attendre D.U.C ? Sûrement. Faut dire qu’il n’y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. La scission s’opère toujours plus. Rap gogol et rappeurs charlizizés. Violence contre bien-pensance. Sinon, il y a aussi le retour des vieux rappeurs. C’est bien, c’est propre, et c’est lassant.
La force de l’interprétation : adieu la France, adieu Elie
Avant LVMH, il y avait eu Tony Sosa. Et encore avant, je ne sais même plus le nom de cette merde. Booba a toujours le sens de la formule, même s’il se répète inlassablement et ressort du réchauffé à chaque morceau ou presque (ses groupies actuelles, pas si fidèles que ça, n’ont pas dû écouter sa discographie entière).
Mais là où Elie l’expatrié revient vraiment fort, c’est dans l’interprétation, d’une puissance qu’on ne lui connaissait plus depuis longtemps déjà. Une force d’interprétation qui l’a souvent distingué des autres rappeurs français et rapproché un peu plus de ses homologues américains. Celle-là même qui avait permit à Biggie, à une époque désormais révolue, de faire passer la véracité ou non de ses textes pour une chose sans grande importance. Booba en est quand même loin : son placement flirte souvent avec la parodie et le ridicule. N’empêche que dans ce domaine, une fois n’est pas coutume, il progresse à sa manière : Temps mort, c’était encore Elie derrière Booba ; depuis, Elie est resté caché derrière un bosquet du Bois de Boulogne, et D.U.C aura peut-être le mérite de nous faire oublier le poney club de Meudon. #MeilleurEspoirDesCésar2015.
 « Mon Pays » a succédé à LVMH. Mon Pays. Adieu mon pays. Un refrain scandé, mélancolique, qui sonne comme des adieux devenus inévitables depuis que la fracture entre la France ou les terres africaines s’est faite trop profonde, trop visible. Adieu mon pays. Un refrain sous autotune qui lorgne du côté des hymnes afro-brésiliens (et orientaux) chantant l’exil. Blessures, douleurs. Mais libération, aussi, de quitter un pays qui n’a l’a jamais vraiment compris, et réciproquement. Adieu mon petit pays. Le résultat ? Un peu de Enrico, trop peu de Césaria. Du Renaud surtout, toujours plus de Renaud – une filiation commencée timidement depuis Panthéon et responsable de ses titres les plus médiocres.
« Mon Pays » a succédé à LVMH. Mon Pays. Adieu mon pays. Un refrain scandé, mélancolique, qui sonne comme des adieux devenus inévitables depuis que la fracture entre la France ou les terres africaines s’est faite trop profonde, trop visible. Adieu mon pays. Un refrain sous autotune qui lorgne du côté des hymnes afro-brésiliens (et orientaux) chantant l’exil. Blessures, douleurs. Mais libération, aussi, de quitter un pays qui n’a l’a jamais vraiment compris, et réciproquement. Adieu mon petit pays. Le résultat ? Un peu de Enrico, trop peu de Césaria. Du Renaud surtout, toujours plus de Renaud – une filiation commencée timidement depuis Panthéon et responsable de ses titres les plus médiocres.![]()
 Des extraits d’album, dont Caracas et Billets violets, qui avaient donc de quoi intriguer. Tout comme le titre, D.U.C, clairement paradoxal : bien que Booba joue le seigneur, jamais son assise n’a paru aussi fragile et contestée – ses références à Heat ne doivent sans doute rien au hasard, lui qui doit fatalement se reconnaître dans la solitude des deux personnages principaux incarnés par De Niro et Pacino. Sur Tony Sosa et LVMH, sa voix se fait plaintive, haletante par moment. Fébrile. Les prémisses de l’âge mûr, peut-être. La forme, crépusculaire, révèle des failles et des doutes capables encore de faire écho à notre propre décadence. Mais il ne faut pas trop espérer non plus. Ça fait plus de 10 ans que Booba, ex nouveau riche éloigné de la réalité de nos rues, n’a plus la même force d’évocation. Parfait, il nous manquait deux trois nouveaux titres pour pousser la fonte et partir au charbon.
Des extraits d’album, dont Caracas et Billets violets, qui avaient donc de quoi intriguer. Tout comme le titre, D.U.C, clairement paradoxal : bien que Booba joue le seigneur, jamais son assise n’a paru aussi fragile et contestée – ses références à Heat ne doivent sans doute rien au hasard, lui qui doit fatalement se reconnaître dans la solitude des deux personnages principaux incarnés par De Niro et Pacino. Sur Tony Sosa et LVMH, sa voix se fait plaintive, haletante par moment. Fébrile. Les prémisses de l’âge mûr, peut-être. La forme, crépusculaire, révèle des failles et des doutes capables encore de faire écho à notre propre décadence. Mais il ne faut pas trop espérer non plus. Ça fait plus de 10 ans que Booba, ex nouveau riche éloigné de la réalité de nos rues, n’a plus la même force d’évocation. Parfait, il nous manquait deux trois nouveaux titres pour pousser la fonte et partir au charbon.