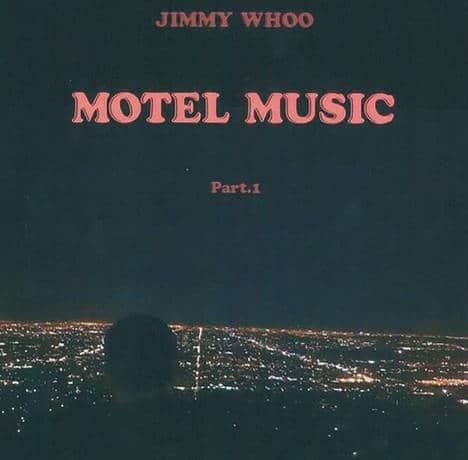Exit le bruit des vagues et le sable des Marquises, bonjour la zone d’exclusion de Fukushima et la sirène d’alarme nucléaire. Un an après l’album de l’apaisement, Disiz libère le montre qui sommeillait au fond du Pacifique : il s’appelle Disizilla.
Après les Bombes, le Japon entame sa reconstruction de nation vaincue. Privé d’armée, placé sous tutelle américaine, l’empire du soleil levant doit réinventer sa société et sa légende. Avant tout, il doit exorciser la peur que le blast nucléaire a imprimé dans sa chair et dans son sol. Sa première réponse visible sera le développement, dans les années 1950, d’un genre cinématographique à part entière : le Kaiju Eiga ou film de monstres. Dans ces films, les Kaiju, créatures gigantesques au pouvoir de destruction sans pareil, mettent à mal les sociétés humaines. Le plus célèbre d’entre eux se nomme Gojira, Godzilla dans nos contrées occidentales. À travers la distance entre le spectateur et l’écran de cinéma, le Japon apprend à mettre de la distance entre lui et l’horreur de la bombe atomique. Pour autant, Godzilla n’est pas un moyen d’oublier, mais bien de se souvenir. Le montre lui-même né des radiations mortelles est une conséquence singulière du traumatisme originel. Monstruosité, singularité et traumatisme, autant de thèmes abordés par Disiz la Peste dans Disizilla.
Parler d’un album aussi dense que Disizilla est loin d’être chose facile. Tout comme son modèle saurien, Disizilla a la peau épaisse. Ses seize titres constituent un pack cohérent et solide doté d’une esthétique soignée. Le ton est donné dès les premières secondes de l’album, qui s’introduit par une note de synthétiseur menaçante et des tambours de guerre. Tout est dit dans le premier couplet : radiations, rage et cratères sont évoqués durant la première minute du disque, le tout enveloppé dans des distorsions vocales électroniques qui confèrent à Disiz son propre « souffle nucléaire ».
De manière générale, l’ambiance de l’album repose sur l’utilisation de synthétiseurs et de mélodies qui rappellent la synthwave, ce sous-genre de pop référençant les canons musicaux des films de genre des années 1980 et 1990, tels que Terminator, Akira ou Tron. Le son est résolument sombre, métallique, digital. Même la jolie fille de Monstrueuse semble être sortie tout droit de laboratoires de la Tyrell Corporation. Les références sont parfois très explicites, comme la ligne mélodique de Disizilla qui reprend pratiquement à la note près le début du morceau The Son of Flynn présent sur la BO de Tron Legacy, et Disiz sonne plus souvent comme Marvin the Paranoïd Androïd du Guide du Voyageur Galactique que comme Godzilla.
Mais la monstruosité que Disiz revendique semble être davantage celle de la société qui rejette ce qui n’entre pas dans son moule que sa monstruosité personnelle. On parle alors du mépris de classe évoqué dans N*Q**R la fac, de la dangereuse solitude des Enfant des rues, et bien entendu du cancer, celui de sa mère, évoqué tout au long de l’album et qui semble être la véritable raison de la colère qui explose partout dans Disizilla.
Difficile de rester insensible à l’écoute du cauchemardesque Terre promise où un jeune Disiz parle à sa mère dévastée elle aussi par les radiations, celles de la chimiothérapie, ou lorsqu’il la décrit comme « une ville bombardée » dans le magnifique Tout partira où l’on reconnaîtra sans peine l’influence d’Avec le temps de Léo Ferré. Difficile aussi de ne pas y voir les monstres dont Disiz parlait déjà il y a huit ans dans Dans le ventre du crocodile.
À travers le terme du monstre, Disiz parle aussi de l’enfance. Le monstre est une dimension informe présente en chacun de nous, que les traumatismes de l’enfance vont sculpter peu à peu pour lui donner sa forme adulte. Chez Disiz, ce monstre s’appelle la peur de perdre sa mère, personnage constamment présent dans son oeuvre, dans les bons comme dans les mauvais moment. Léa, Maïram, Sally et Thioub, Autodance, Le temps précieux sont autant de morceaux où Disiz nous rappelle que c’est sa mère qui est son point cardinal et sa boussole tout à la fois.
Cette mutation invisible de l’être est d’ailleurs un autre thème central de l’oeuvre de Disiz la Peste (lui aussi déjà évoqué dans Dans le Ventre du crocodile), d’autant plus que Disiz n’a jamais cherché à faire de sa discographie un bloc monochrome. De ses débuts de jeune rappeur sympa à sa vie de père de famille, en passant par son retour sur les bancs de la fac, sa rencontre avec Grems et ses expérimentations rock, Disiz a toujours été, par essence, un artiste mutant qui s’est toujours montré relativement transparent vis-à-vis de son public. Si l’on aura parfois eu l’impression que ses changements de couleur artistique pouvaient faire de La Peste un caméléon cherchant à se fondre dans le décor, Disizilla fait au contraire figure d’album radical comme on en avait pas entendu de sa part depuis Disiz the End.
Normal. Disiz, tout comme les Japonais, avait besoin de prendre de la distance vis-à-vis des événements récents de sa vie, il réalise donc son propre film de monstres, et extériorise ses peurs dans un exercice cathartique pratiquement sans filtre. Coup de chance, le MC d’Evry se montre également monstrueux sur des morceaux comme Mastodonte, Fuck l’époque ou encore Cercle rouge, le pendant brutal du Carré Bleu de Pacifique, en synergie avec un Niska hyper à l’aise sur la prod de Pepside. Autant de morceaux qui laissent présager des performances électriques en live.
Au final, il n’en reste pas moins difficile de formuler un jugement de valeur sur Disizilla, comme il le sera sans doute sur la plupart des projets à venir de Disiz. À 40 ans, Serigne M’baye Gueye a passé l’âge d’être évalué, surtout pour son douzième album. À la manière d’un Nero Nemesis, Disizilla ne fait qu’installer un peu plus Disiz au panthéon du rap français comme l’un des artistes les plus performants du genre, dont la musique continuera d’irradier toute une génération d’auditeurs et de MC’s.